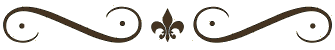Anthology
of Louisiana Literature
François-René de Chateaubriand.
René.


Girodet-Trioson, Portrait de F.-R. de Chateaubriand, (détail; vers 1807)
Musée de Saint-Malo, France.
|
René
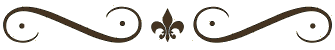
(publié dans le Génie du Christianisme
en 1802,
publié séparément du Génie
du Christianisme en 1805)
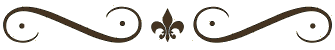
D'après éd. Furne, 1832
orthographe modifiée
|
En arrivant chez les Natchez, René avait été
obligé de prendre une épouse, pour se conformer
aux moeurs des Indiens; mais il ne vivait point avec elle. Un
penchant mélancolique l’entraînait au fond des bois;
il y passait seul des journées entières, et semblait
sauvage parmi des sauvages. Hors Chactas, son père adoptif,
et le P. Souël, missionnaire au fort Rosalie (Note 1) il avait renoncé au commerce des hommes. Ces deux vieillards
avaient pris beaucoup d’empire sur son cœur: le premier, par
une indulgence aimable; l’autre, au contraire, par une extrême
sévérité. Depuis la chasse du castor, où
le Sachem aveugle raconta ses aventures à René,
celui-ci n’avait jamais voulu parler des siennes. Cependant Chactas
et le missionnaire désiraient vivement connaître
par quel malheur un Européen bien né avait été
conduit à l’étrange résolution de s’ensevelir
dans les déserts de la Louisiane. René avait toujours
donné pour motifs de ses refus, le peu d’intérêt
de son histoire qui se bornait, disait-il, à celle de ses
pensées et de ses sentiments. "Quant à l’événement
qui m’a déterminé à passer en Amérique,
ajoutait-il, je le dois ensevelir dans un éternel oubli."

Quelques années s’écoulèrent de la sorte,
sans que les deux vieillards lui pussent arracher son secret.
Une lettre qu’il reçut d’Europe, par le bureau des Missions
étrangères, redoubla tellement sa tristesse, qu’il
fuyait jusqu’à ses vieux amis. Ils n’en furent que plus
ardents à le presser de leur ouvrir son coeur; ils y mirent
tant de discrétion, de douceur et d’autorité, qu’il
fut enfin obligé de les satisfaire. II prit donc jour avec
eux, pour leur raconter, non les aventures de sa vie, puisqu’il
n’en avait point éprouvé, mais les sentiments secrets
de son âme.

Le 21 de ce mois que les Sauvages appellent la lune des fleurs,
René se rendit à la cabane de Chactas. Il donna
le bras au Sachem, et le conduisit sous un sassafras, au bord
du Meschacebé. Le P. Souël ne tarda pas à arriver
au rendez-vous. L’aurore se levait: à quelque distance
dans la plaine, on apercevait le village des Natchez, avec son
bocage de mûriers, et ses cabanes qui ressemblent à
des ruches d’abeilles. La colonie française et le fort
Rosalie se montraient sur la droite, au bord du fleuve. Des tentes,
des maisons à moitié bâties, des forteresses
commencées, des défrichements couverts de Nègres,
des groupes de Blancs et d’Indiens, présentaient dans ce
petit espace, le contraste des moeurs sociales et des moeurs sauvages.
Vers l’Orient, au fond de la perspective, le soleil commençait
à paraître entre les sommets brisés des Apalaches,
qui se dessinaient comme des caractères d’azur dans les
hauteurs dorées du ciel; à l’occident, le Meschacebé
roulait ses ondes dans un silence magnifique, et formait la bordure
du tableau avec une inconcevable grandeur.

Le jeune homme et le missionnaire admirèrent quelque temps
cette belle scène, en plaignant le Sachem qui ne pouvait
plus en jouir; ensuite le P. Souël et Chactas s’assirent
sur le gazon, au pied de l’arbre; René prit sa place au
milieu d’eux, et après un moment de silence, il parla de
la sorte à ses vieux amis:
Je ne puis, en commençant mon récit, me défendre
d’un mouvement de honte. La paix de vos coeurs respectables vieillards,
et le calme de la nature autour de moi, me font rougir du trouble
et de l’agitation de mon âme.
Combien vous aurez pitié de moi! Que mes éternelles
inquiétudes vous paraîtront misérables! Vous
qui avez épuisé tous les chagrins de la vie, que
penserez-vous d’un jeune homme sans force et sans vertu, qui trouve
en lui-même son tourment, et ne peut guère se plaindre
que des maux qu’il se fait à lui-même? Hélas,
ne le condamnez pas; il a été trop puni!
J’ai coûté la vie à ma mère en venant
au monde; j’ai été tiré de son sein avec
le fer. J’avais un frère que mon père bénit,
parce qu’il voyait en lui son fils aîné. Pour moi,
livré de bonne heure à des mains étrangères,
je fus élevé loin du toit paternel.

Mon humeur était impétueuse, mon caractère
inégal. Tour à tour bruyant et joyeux, silencieux
et triste, je rassemblais autour de moi mes jeunes compagnons;
puis, les abandonnant tout à coup, j’allais m’asseoir à
l’écart pour contempler la nue fugitive, ou entendre la
pluie tomber sur le feuillage.
Chaque automne, je revenais au château paternel, situé
au milieu des forêts, près d’un lac, dans une province
reculée.
Timide et contraint devant mon père, je ne trouvais l’aise
et le contentement qu’auprès de ma soeur Amélie.
Une douce conformité d’humeur et de goûts m’unissait
étroitement à cette soeur; elle était un
peu plus âgée que moi. Nous aimions à gravir
les coteaux ensemble, à voguer sur le lac, à parcourir
les bois à la chute des feuilles: promenades dont le souvenir
remplit encore mon âme de délices. O illusions de
l’enfance et de la patrie, ne perdez-vous jamais vos douceurs?
Tantôt nous marchions en silence, prêtant l’oreille
au sourd mugissement de l’automne, ou au bruit des feuilles séchées,
que nous traînions tristement sous nos pas; tantôt,
dans nos jeux innocents, nous poursuivions l’hirondelle dans la
prairie, arc-en-ciel sur les collines pluvieuses; quelquefois
aussi nous murmurions des vers que nous inspirait le spectacle
de la nature. Jeune, je cultivais les Muses; il n’y a rien de
plus poétique, dans la fraîcheur de ses passions,
qu’un coeur de seize années. Le matin de la vie est comme
le matin du jour, plein de pureté, d’images et d’harmonies.

Les dimanches et les jours de fête, j’ai souvent entendu,
dans le grand bois, à travers les arbres, les sons de la
cloche lointaine qui appelait au temple l’homme des champs. Appuyé
contre le tronc d’un ormeau, j’écoutais en silence le pieux
murmure. Chaque frémissement de l’airain portait à
mon âme naïve l’innocence des moeurs champêtres,
le calme de la solitude, le charme de la religion, et la délectable
mélancolie des souvenirs de ma première enfance.
Oh! quel coeur si mal fait n’a tressailli au bruit des cloches
de son lieu natal, de ces cloches qui frémirent de joie
sur son berceau, qui annoncèrent son avènement à
la vie, qui marquèrent le premier battement de son coeur,
qui publièrent dans tous les lieux d’alentour la sainte
allégresse de son père, les douleurs et les joies
encore plus ineffables de sa mère! Tout se trouve dans
les rêveries enchantées où nous plonge le
bruit de la cloche natale: religion, famille, patrie, et le berceau
et la tombe, et le passé et l’avenir.

II est vrai qu’Amélie et moi nous jouissions plus que
personne de ces idées graves et tendres, car nous avions
tous les deux un peu de tristesse au fond du coeur: nous tenions
cela de Dieu ou de notre mère.
Cependant mon père fut atteint d’une maladie qui le conduisit
en peu de jours au tombeau. II expira dans mes bras. J’appris
à connaître la mort sur les lèvres de celui
qui m’avait donné la vie. Cette impression fut grande;
elle dure encore. C’est la première fois que l’immortalité
de l’âme s’est présentée clairement à
mes yeux. Je ne pus croire que ce corps inanimé était
en moi l’auteur de la pensée: je sentis qu’elle me devait
venir d’une autre source; et dans une sainte douleur qui approchait
de la joie, j’espérai me rejoindre un jour à l’esprit
de mon père.
Un autre phénomène me confirma dans cette haute
idée. Les traits paternels avaient pris au cercueil quelque
chose de sublime. Pourquoi cet étonnant mystère
ne serait-il pas l’indice de notre immortalité? Pourquoi
la mort qui sait tout, n’aurait-elle pas gravé sur le front
de sa victime les secrets d’un autre univers? Pourquoi n’y aurait-il
pas dans la tombe quelque grande vision de l’éternité?

Amélie, accablée de douleur, était retirée
au fond d’une tour, d’où elle entendit retentir, sous les
voûtes du château gothique, le chant des prêtres
du convoi et les sons de la cloche funèbre.
J’accompagnai mon père à son dernier asile; la
terre se referma sur sa dépouille; l’éternité
et l’oubli le pressèrent de tout leur poids; le soir même
l’indifférent passait sur sa tombe; hors pour sa fille
et pour son fils, c’était déjà comme s’il
n’avait jamais été.
II fallut quitter le toit paternel, devenu l’héritage
de mon frère: je me retirai avec Amélie chez de
vieux parents.
Arrêté à l’entrée des voies trompeuses
de la vie, je les considérais l’une après l’autre,
sans m’y oser engager. Amélie m’entretenait souvent du
bonheur de la vie religieuse; elle me disait que j’étais
le seul lien qui la retînt dans le monde, et ses yeux s’attachaient
sur moi avec tristesse.
Le coeur ému par ces conversations pieuses, je portais
souvent mes pas vers un monastère, voisin de mon nouveau
séjour; un moment même j’eus la tentation d’y cacher
ma vie. Heureux ceux qui ont fini leur voyage, sans avoir quitté
le port, et qui n’ont point, comme moi, traîné d’inutiles
jours sur la terre!

Les Européens incessamment agités sont obligés
de se bâtir des solitudes. Plus notre coeur est tumultueux
et bruyant, plus le calme et le silence nous attirent. Ces hospices
de mon pays, ouverts aux malheureux et aux faibles, sont souvent
cachés dans des vallons qui portent au coeur le vague sentiment
de l’infortune et l’espérance d’un abri; quelquefois aussi
on les découvre sur de hauts sites où l’âme
religieuse, comme une plante des montagnes, semble s’élever
vers le ciel pour lui offrir ses parfums.
Je vois encore le mélange majestueux des eaux et des bois
de cette antique abbaye où je pensai dérober ma
vie aux caprices du sort; j’erre encore au déclin du jour
dans ces cloîtres retentissants et solitaires. Lorsque la
lune éclairait à demi les piliers des arcades, et
dessinait leur ombre sur le mur opposé, je m’arrêtais
à contempler la croix qui marquait le champ de la mort,
et les longues herbes qui croissaient entre les pierres des tombes.
O hommes, qui ayant vécu loin du monde, avez passé
du silence de la vie au silence de la mort, de quel dégoût
de la terre vos tombeaux ne remplissaient-ils point mon coeur!
Soit inconstance naturelle, soit préjugé contre
la vie monastique, je changeai mes desseins; je me résolus
à voyager. Je dis adieu à ma soeur; elle me serra
dans ses bras avec un mouvement qui ressemblait à de la
joie, comme si elle eût été heureuse de me
quitter; je ne pus me défendre d’une réflexion amère
sur l’inconséquence des amitiés humaines.

Cependant, plein d’ardeur, je m’élançai seul sur
cet orageux océan du monde, dont je ne connaissais ni les
ports, ni les écueils. Je visitai d’abord les peuples qui
ne sont plus; je m’en allai m’asseyant sur les débris de
Rome et de la Grèce: pays de forte et d’ingénieuse
mémoire, où les palais sont ensevelis dans la poudre,
et les mausolées des rois cachés sous les ronces.
Force de la nature, et faiblesse de l’homme: un brin d’herbe perce
souvent le marbre le plus dur de ces tombeaux, que tous ces morts,
si puissants, ne soulèveront jamais!
Quelquefois une haute colonne se montrait seule debout dans un
désert, comme une grande pensée s’élève,
par intervalles, dans une âme que le temps et le malheur
ont dévastée.

Je méditai sur ces monuments dans tous les accidents et
à toutes les heures de la journée. Tantôt
ce même soleil qui avait vu jeter les fondements de ces
cités, se couchait majestueusement, à mes yeux,
sur leurs ruines; tantôt la lune se levant dans un ciel
pur, entre deux urnes cinéraires à moitié
brisées, me montrait les pâles tombeaux. Souvent
aux rayons de cet astre qui alimente les rêveries, j’ai
cru voir le Génie des souvenirs, assis tout pensif à
mes côtés.
Mais je me lassai de fouiller dans des cercueils, où je
ne remuais trop souvent qu’une poussière criminelle.
Je voulus voir si les races vivantes m’offriraient plus de vertus,
ou moins de malheurs que les races évanouies. Comme je
me promenais un jour dans une grande cité, en passant derrière
un palais, dans une cour retirée et déserte, j’aperçus
une statue qui indiquait du doigt un lieu fameux par un sacrifice
(Note 2) . Je fus frappé du silence de ces lieux; le vent
seul gémissait autour du marbre tragique. Des manoeuvres
étaient couchés avec indifférence au pied
de la statue, ou taillaient des pierres en sifflant. Je leur demandai
ce que signifiait ce monument: les uns purent à peine me
le dire, les autres ignoraient la catastrophe qu’il retraçait.
Rien ne m’a plus donné la juste mesure des événements
de la vie, et du peu que nous sommes. Que sont devenus ces personnages
qui firent tant de bruit? Le temps a fait un pas, et la face de
la terre a été renouvelée.
Je recherchai surtout dans mes voyages les artistes et ces hommes
divins qui chantent les Dieux sur la lyre, et la félicité
des peuples qui honorent les lois, la religion et les tombeaux.
Ces chantres sont de race divine, ils possèdent le seul
talent incontestable dont le ciel ait fait présent à
la terre. Leur vie est à la fois naïve et sublime;
ils célèbrent les Dieux avec une bouche d’or, et
sont les plus simples des hommes; ils causent comme des immortels
ou comme de petits enfants; ils expliquent les lois de l’univers,
et ne peuvent comprendre les affaires les plus innocentes de la
vie; ils ont des idées merveilleuses de la mort, et meurent,
sans s’en apercevoir, comme des nouveau-nés.
Sur les monts de la Calédonie, le dernier Barde qu’on
ait ouï dans ces déserts me chanta les poèmes
dont un héros consolait jadis sa vieillesse. Nous étions
assis sur quatre pierres rongées de mousse; un torrent
coulait à nos pieds; le chevreuil paissait à quelque
distance parmi les débris d’une tour, et le vent des mers
sifflait sur la bruyère de Cona. Maintenant la religion
chrétienne, fille aussi des hautes montagnes, a placé
des croix sur les monuments des héros de Morven, et touché
la harpe de David, au bord du même torrent où Ossian
fit gémir la sienne. Aussi pacifique que les divinités
de Selma étaient guerrières elle garde des troupeaux
où Fingal livrait des combats et elle a répandu
des anges de paix dans les nuages qu’habitaient des fantômes
homicides.

L’ancienne et riante Italie m’offrit la foule de ses chefs-d’oeuvre.
Avec quelle sainte et poétique horreur j’errais dans ces
vastes édifices consacrés par les arts à
la religion! Quel labyrinthe de colonnes! Quelle succession d’arches
et de voûtes! Qu’ils sont beaux ces bruits qu’on entend
autour des dômes, semblables aux rumeurs des flots dans
l’Océan, aux murmures des vents dans les forêts,
ou à la voix de Dieu dans son temple! L’architecte bâtit,
pour ainsi dire, les idées du poète et les fait
toucher aux sens.
Cependant qu’avais-je appris jusqu’alors avec tant de fatigue?
Rien de certain parmi les anciens, rien de beau parmi les modernes.
Le passé et le présent sont deux statues incomplètes:
l’une a été retirée toute mutilée
du débris des âges; l’autre n’a pas encore reçu
sa perfection de l’avenir.
Mais peut-être, mes vieux amis, vous surtout, habitants
du désert, êtes-vous étonnés que dans
ce récit de mes voyages, je ne vous aie pas une seule fois
entretenus des monuments de la nature ?
Un jour, j’étais monté au sommet de l’Etna, volcan
qui brûle au milieu d’une île. Je vis le soleil se
lever dans l’immensité de l’horizon au-dessous de moi,
la Sicile resserrée comme un point à mes pieds,
et la mer déroulée au loin dans les espaces. Dans
cette vue perpendiculaire du tableau, les fleuves ne me semblaient
plus que des lignes géographiques tracées sur une
carte; mais, tandis que d’un côté mon oeil apercevait
ces objets, de l’autre il plongeait dans le cratère de
l’Etna, dont je découvrais les entrailles brûlantes,
entre les bouffées d’une noire vapeur.
Un jeune homme plein de passions, assis sur la bouche d’un volcan,
et pleurant sur les mortels dont à peine il voyait à
ses pieds les demeures, n’est sans doute, ô vieillard, qu’un
objet digne de votre pitié; mais, quoi que vous puissiez
penser de René, ce tableau vous offre l’image de son caractère
et de son existence: c’est ainsi que toute ma vie j’ai eu devant
les yeux une création à la fois immense et imperceptible,
et un abîme ouvert à mes côtés."
En prononçant ces derniers mots, René se tut, et
tomba subitement dans la rêverie. Le P. Souël le regardait
avec étonnement, et le vieux Sachem aveugle qui n’entendait
plus parler le jeune homme, ne savait que penser de ce silence.
avait les yeux attachés sur un groupe d’Indiens
qui passaient gaiement dans la plaine. Tout à coup sa physionomie
s’attendrit, des larmes coulent de ses yeux, il s’écrie:
Heureux Sauvages! Oh! que ne puis-je jouir de la paix qui
vous accompagne toujours! Tandis qu’avec si peu de fruit je parcourais
tant de contrées, vous, assis tranquillement sous vos chênes,
vous laissiez couler les jours sans les compter. Votre raison
n’était que vos besoins, et vous arriviez, mieux que moi,
au résultat de la sagesse, comme l’enfant, entre les jeux
et le sommeil. Si cette mélancolie qui s’engendre de l’excès
du bonheur atteignait quelquefois votre âme, bientôt
vous sortiez de cette tristesse passagère, et votre regard
levé vers le Ciel, cherchait avec attendrissement ce je
ne sais quoi inconnu qui prend pitié du pauvre Sauvage."

Ici la voix de René expira de nouveau, et le jeune homme
pencha la tête sur sa poitrine. Chactas, étendant
le bras dans l’ombre, et prenant le bras de son fils, lui cria
d’un ton ému: "Mon fils! mon cher fils!" A ces
accents, le frère d’Amélie revenant à lui,
et rougissant de son trouble, pria son père de lui pardonner.
Alors le vieux Sauvage: "Mon jeune ami, les mouvements d’un
coeur comme le tien ne sauraient être égaux; modère
seulement ce caractère qui t’a déjà fait
tant de mal. Si tu souffres plus qu’un autre des choses de la
vie, il ne faut pas t’en étonner; une grande âme
doit contenir plus de douleur qu’une petite. Continue ton récit.
Tu nous as fait parcourir une partie de l’Europe, fais-nous connaître
ta patrie. Tu sais que j’ai vu la France, et quels liens m’y ont
attaché; j’aimerai à entendre parler de ce grand
Chef (Note 3) , qui n’est plus, et dont j’ai visité la superbe
cabane. Mon enfant, je ne vis plus que par la mémoire.
Un vieillard avec ses souvenirs ressemble au chêne décrépit
de nos bois: ce chêne ne se décore plus de son propre
feuillage, mais il couvre quelquefois sa nudité des plantes
étrangères qui ont végété sur
ses antiques rameaux."
Le frère d’Amélie, calmé par ces paroles,
reprit ainsi l’histoire de son coeur:
Hélas! mon père, je ne pourrai t’entretenir
de ce grand siècle dont je n’ai vu que la fin dans mon
enfance, et qui n’était plus lorsque je rentrai dans ma
patrie. Jamais un changement plus étonnant et plus soudain
ne s’est opéré chez un peuple. De la hauteur du
génie, du respect pour la religion, de la gravité
des moeurs, tout était subitement descendu à la
souplesse de l’esprit, à l’impiété, à
la corruption.
C’était donc bien vainement que j’avais espéré
retrouver dans mon pays de quoi calmer cette inquiétude,
cette ardeur de désir qui me suit partout. L’étude
du monde ne m’avait rien appris, et pourtant je n’avais plus la
douceur de l’ignorance.
Ma soeur, par une conduite inexplicable, semblait se plaire à
augmenter mon ennui; elle avait quitté Paris quelques jours
avant mon arrivée. Je lui écrivis que je comptais
l’aller rejoindre; elle se hâta de me répondre pour
me détourner de ce projet, sous prétexte qu’elle
était incertaine du lieu où l’appelleraient ses
affaires. Quelles tristes réflexions ne fis-je point alors
sur l’amitié, que la présence attiédit, que
l’absence efface, qui ne résiste point au malheur, et encore
moins à la prospérité!
Je me trouvai bientôt plus isolé dans ma patrie,
que je ne l’avais été sur une terre étrangère.
Je voulus me jeter pendant quelque temps dans un monde qui ne
me disait rien et qui ne m’entendait pas. Mon âme, qu’aucune
passion n’avait encore usée, cherchait un objet qui pût
l’attacher; mais je m’aperçus que je donnais plus que je
ne recevais. Ce n’était ni un langage élevé,
ni un sentiment profond qu’on demandait de moi. Je n’étais
occupé qu’à rapetisser ma vie, pour la mettre au
niveau de la société. Traité partout d’esprit
romanesque, honteux du rôle que je jouais, dégoûté
de plus en plus des choses et des hommes, je pris le parti de
me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignoré.
Je trouvai d’abord assez de plaisir dans cette vie obscure et
indépendante. Inconnu, je me mêlais à la foule:
vaste désert d’hommes!
Souvent assis dans une église peu fréquentée,
je passais des heures entières en méditation. Je
voyais de pauvres femmes venir se prosterner devant le Très-Haut,
ou des pécheurs s’agenouiller au tribunal de la pénitence.
Nul ne sortait de ces lieux sans un visage plus serein, et les
sourdes clameurs qu’on entendait au dehors semblaient être
les flots des passions et les orages du monde qui venaient expirer
au pied du temple du Seigneur. Grand Dieu, qui vis en secret couler
mes larmes dans ces retraites sacrées, tu sais combien
de fois je me jetai à tes pieds, pour te supplier de me
décharger du poids de l’existence, ou de changer en moi
le vieil homme! Ah! qui n’a senti quelquefois le besoin de se
régénérer, de se rajeunir aux eaux du torrent,
de retremper son âme à la fontaine de vie? Qui ne
se trouve quelquefois accablé du fardeau de sa propre corruption,
et incapable de rien faire de grand, de noble, de juste?
Quand le soir était venu, reprenant le chemin de ma retraite,
je m’arrêtais sur les ponts, pour voir se coucher le soleil.
L’astre, enflammant les vapeurs de la cité, semblait osciller
lentement dans un fluide d’or, comme le pendule de l’horloge des
siècles. Je me retirais ensuite avec la nuit, à
travers un labyrinthe de rues solitaires. En regardant les lumières
qui brillaient dans les demeures des hommes, je me transportais
par la pensée au milieu des scènes de douleur et
de joie qu’elles éclairaient; et je songeais que sous tant
de toits habités, je n’avais pas un ami. Au milieu de mes
réflexions, l’heure venait frapper à coups mesurés
dans la tour de la cathédrale gothique; elle allait se
répétant sur tous les tons et à toutes les
distances d’église en église. Hélas! chaque
heure dans la société ouvre un tombeau, et fait
couler des larmes.
Cette vie, qui m’avait d’abord enchanté, ne tarda pas
à me devenir insupportable. Je me fatiguai de la répétition
des mêmes scènes et des mêmes idées.
Je me mis à sonder mon coeur, à me demander ce que
je désirais. Je ne le savais pas; mais je crus tout à
coup que les bois me seraient délicieux. Me voilà
soudain résolu d’achever, dans un exil champêtre,
une carrière à peine commencée, et dans laquelle
j’avais déjà dévoré des siècles.
J’embrassai ce projet avec l’ardeur que je mets à tous
mes desseins; je partis précipitamment pour m’ensevelir
dans une chaumière, comme j’étais parti autrefois
pour faire le tour du monde.
On m’accuse d’avoir des goûts inconstants, de ne pouvoir
jouir longtemps de la même chimère, d’être
la proie d’une imagination qui se hâte d’arriver au fond
de mes plaisirs, comme si elle était accablée de
leur durée; on m’accuse de passer toujours le but que je
puis atteindre: hélas! je cherche seulement un bien inconnu,
dont l’instinct me poursuit. Est-ce ma faute, si je trouve partout
des bornes, si ce qui est fini n’a pour moi aucune valeur? Cependant
je sens que j’aime la monotonie des sentiments de la vie, et si
j’avais encore la folie de croire au bonheur, je le chercherais
dans l’habitude.
La solitude absolue, le spectacle de la nature, me plongèrent
bientôt dans un état presque impossible à
décrire. Sans parents, sans amis, pour ainsi dire seul
sur la terre, n’ayant point encore aimé, j’étais
accablé d’une surabondance de vie. Quelquefois je rougissais
subitement, et je sentais couler dans mon coeur comme des ruisseaux
d’une lave ardente; quelquefois je poussais des cris involontaires,
et la nuit était également troublée de mes
songes et de mes veilles. II me manquait quelque chose pour remplir
l’abîme de mon existence: je descendais dans la vallée,
je m’élevais sur la montagne, appelant de toute la force
de mes désirs l’idéal objet d’une flamme future;
je l’embrassais dans les vents; je croyais l’entendre dans les
gémissements du fleuve; tout était ce fantôme
imaginaire, et les astres dans les cieux, et le principe même
de vie dans l’univers.
Toutefois cet état de calme et de trouble, d’indigence
et de richesse, n’était pas sans quelques charmes. Un jour
je m’étais amusé à effeuiller une branche
de saule sur un ruisseau, et à attacher une idée
à chaque feuille que le courant entraînait. Un roi
qui craint de perdre sa couronne par une révolution subite,
ne ressent pas des angoisses plus vives que les miennes, à
chaque accident qui menaçait les débris de mon rameau.
O faiblesse des mortels! O enfance du coeur humain qui ne vieillit
jamais! Voilà donc à quel degré de puérilité
notre superbe raison peut descendre! Et encore est-il vrai que
bien des hommes attachent leur destinée à des choses
d’aussi peu de valeur que mes feuilles de saule.

Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives, que
j’éprouvais dans mes promenades? Les sons que rendent les
passions dans le vide d’un coeur solitaire, ressemblent au murmure
que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert:
on en jouit, mais on ne peut les peindre.
L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes: j’entrai
avec ravissement dans les mois des tempêtes. Tantôt
j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu
des vents, des nuages et des fantômes; tantôt j’enviais
jusqu’au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses
mains à l’humble feu de broussailles qu’il avait allumé
au coin d’un bois. J’écoutais ses chants mélancoliques,
qui me rappelaient que dans tout pays, le chant naturel de l’homme
est triste, lors même qu’il exprime le bonheur. Notre coeur
est un instrument incomplet, une lyre où il manque des
cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents
de la joie sur le ton consacré aux soupirs.
Le jour je m’égarais sur de grandes bruyères terminées
par des forêts. Qu’il fallait peu de chose à ma rêverie:
une feuille séchée que le vent chassait devant moi,
une cabane dont la fumée s’élevait dans la cime
dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au
souffle du nord sur le tronc d’un chêne, une roche écartée
un étang désert où le jonc flétri
murmurait! Le clocher du hameau, s’élevant au loin dans
la vallée, a souvent attiré mes regards; souvent
j’ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus
de ma tête Je me figurais les bords ignorés, les climats
lointains où ils se rendent; j’aurais voulu être
sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait; je sentais
que je n’étais moi-même qu’un voyageur; mais une
voix du ciel semblait me dire: "Homme, la saison de ta migration
n’est pas encore venue; attends que le vent de la mort se lève,
alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues
que ton coeur demande."
Levez-vous vite, orages désirés, qui devez emporter
René dans les espaces d’une autre vie! Ainsi disant, je
marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent
sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie ni frimas, enchanté,
tourmenté, et comme possédé par le démon
de mon coeur.
La nuit, lorsque l’aquilon ébranlait ma chaumière,
que les pluies tombaient en torrent sur mon toit, qu’à
travers ma fenêtre je voyais la lune sillonner les nuages
amoncelés, comme un pâle vaisseau qui laboure les
vagues, il me semblait que la vie redoublait au fond de mon coeur,
que j’aurais eu la puissance de créer des mondes. Ah! si
j’avais pu faire partager à une autre les transports que
j’éprouvais! O Dieu! si tu m’avais donné une femme
selon mes désirs; si, comme à notre premier père,
tu m’eusses amené par la main une Eve tirée de moi-même...
Beauté céleste, je me serais prosterné devant
toi; puis, te prenant dans mes bras, j’aurais prié l’Eternel
de te donner le reste de ma vie.
Hélas! j’étais seul, seul sur la terre! Une langueur
secrète s’emparait de mon corps. Ce dégoût
de la vie que j’avais ressenti dès mon enfance, revenait
avec une force nouvelle. Bientôt mon coeur ne fournit plus
d’aliment à ma pensée, et je ne m’apercevais de
mon existence que par un profond sentiment d’ennui.
Je luttai quelque temps contre mon mal, mais avec indifférence
et sans avoir la ferme résolution de le vaincre. Enfin,
ne pouvant trouver de remède à cette étrange
blessure de mon coeur, qui n’était nulle part et qui était
partout, je résolus de quitter la vie.
Prêtre du Très-Haut, qui m’entendez, pardonnez à
un malheureux que le ciel avait presque privé de la raison.
J’étais plein de religion, et je raisonnais en impie; mon
coeur aimait Dieu, et mon esprit le méconnaissait; ma conduite,
mes discours, mes sentiments, mes pensées, n’étaient
que contradiction, ténèbres, mensonges. Mais l’homme
sait-il bien toujours ce qu’il veut, est-il toujours sûr
de ce qu’il pense?
Tout m’échappait à la fois, l’amitié, le
monde, la retraite. J’avais essayé de tout, et tout m’avait
été fatal. Repoussé par la société,
abandonné d’Amélie, quand la solitude vint à
me manquer, que me restait-il? C’était la dernière
planche sur laquelle j ’avais espéré me sauver, et
je la sentais encore s’enfoncer dans l’abîme!
Décidé que j’étais à me débarrasser
du poids de la vie, je résolus de mettre toute ma raison
dans cet acte insensé. Rien ne me pressait; je ne fixai
point le moment du départ, afin de savourer à longs
traits les derniers moments de l’existence, et de recueillir toutes
mes forces, à l’exemple d’un Ancien, pour sentir mon âme
s’échapper.
Cependant je crus nécessaire de prendre des arrangements
concernant ma fortune, et je fus obligé d’écrire
à Amélie. II m’échappa quelques plaintes
sur son oubli, et je laissai sans doute percer l’attendrissement
qui surmontait peu à peu mon coeur. Je m’imaginais pourtant
avoir bien dissimulé mon secret; mais ma soeur accoutumée
à lire dans les replis de mon âme, le devina sans
peine. Elle fut alarmée du ton de contrainte qui régnait
dans ma lettre, et de mes questions sur des affaires dont je ne
m’étais jamais occupé. Au lieu de me répondre,
elle me vint tout à coup surprendre.
Pour bien sentir quelle dut être dans la suite l’amertume
de ma douleur, et quels furent mes premiers transports en revoyant
Amélie, il faut vous figurer que c’était la seule
personne au monde que j’eusse aimée, que tous mes sentiments
se venaient confondre en elle, avec la douceur des souvenirs de
mon enfance Je reçus donc Amélie dans une sorte
d’extase de coeur. Il y avait si longtemps que je n’avais trouvé
quelqu’un qui m’entendît, et devant qui je pusse ouvrir
mon âme!
Amélie se jetant dans mes bras, me dit: "Ingrat,
tu veux mourir, et ta soeur existe! Tu soupçonnes son coeur!
Ne t’explique point, ne t’excuse point, je sais tout; j’ai tout
compris, comme si j’avais été avec toi. Est-ce moi
que l’on trompe, moi, qui ai vu naître tes premiers sentiments?
Voilà ton malheureux caractère, tes dégoûts,
tes injustices. Jure, tandis que je te presse sur mon coeur, jure
que c’est la dernière fois que tu te livreras à
tes folies; fais le serment de ne jamais attenter à tes
jours."
En prononçant ces mots, Amélie me regardait avec
compassion et tendresse, et couvrait mon front de ses baisers;
c’était presque une mère, c’était quelque
chose de plus tendre. Hélas! mon coeur se rouvrit à
toutes les joies; comme un enfant, je ne demandais qu’à
être consolé; je cédai à l’empire d’Amélie;
elle exigea un serment solennel; je le fis sans hésiter,
ne soupçonnant même pas que désormais je pusse
être malheureux.
Nous fûmes plus d’un mois à nous accoutumer à
l’enchantement d’être ensemble. Quand le matin, au lieu
de me trouver seul, j’entendais la voix de ma soeur, j’éprouvais
un tressaillement de joie et de bonheur. Amélie avait reçu
de la nature quelque chose de divin; son âme avait les mêmes
grâces innocentes que son corps, la douceur de ses sentiments
était infinie; il n’y avait rien que de suave et d’un peu
rêveur dans son esprit; on eût dit que son coeur,
sa pensée et sa voix soupiraient comme de concert; elle
tenait de la femme la timidité et l’amour, et de l’ange
la pureté et la mélodie.
Le moment était venu où j’allais expier toutes
mes inconséquences. Dans mon délire j’avais été
jusqu’à désirer d’éprouver un malheur, pour
avoir du moins un objet réel de souffrance: épouvantable
souhait que Dieu, dans sa colère, a trop exaucé!
Que vais-je vous révéler, ô mes amis! Voyez
les pleurs qui coulent de mes yeux. Puis-je même... Il y
a quelques jours, rien n’aurait pu m’arracher ce secret... A présent
tout est fini!
Toutefois, ô vieillards, que cette histoire soit à
jamais ensevelie dans le silence: souvenez-vous qu’elle n’a été
racontée que sous l’arbre du désert.
L’hiver finissait, lorsque je m’aperçus qu’Amélie
perdait le repos et la santé qu’elle commençait
à me rendre. Elle maigrissait; ses yeux se creusaient;
sa démarche était languissante, et sa voix troublée.
Un jour, je la surpris tout en larmes au pied d’un crucifix. Le
monde, la solitude, mon absence, ma présence, la nuit,
le jour, tout l’alarmait. D’involontaires soupirs venaient expirer
sur ses lèvres; tantôt elle soutenait, sans se fatiguer,
une longue course; tantôt elle se traînait à
peine; elle prenait et laissait son ouvrage, ouvrait un livre
sans pouvoir lire, commençait une phrase qu’elle n’achevait
pas, fondait tout à coup en pleurs, et se retirait pour
prier.
En vain je cherchais à découvrir son secret. Quand
je l’interrogeais, en la pressant dans mes bras, elle me répondait,
avec un sourire, qu’elle était comme moi, qu’elle ne savait
pas ce qu’elle avait.
Trois mois se passèrent de la sorte, et son état
devenait pire chaque jour. Une correspondance mystérieuse
me semblait être la cause de ses larmes, car elle paraissait
ou plus tranquille ou plus émue, selon les lettres qu’elle
recevait. Enfin, un matin, l’heure à laquelle nous déjeunions
ensemble étant passée, je monte à son appartement;
je frappe, on ne me répond point; j’entrouvre la porte,
il n’y avait personne dans la chambre. J’aperçois sur la
cheminée un paquet à mon adresse. Je le saisis en
tremblant, je l’ouvre, et je lis cette lettre, que je conserve
pour m’ôter à l’avenir tout mouvement de joie.
A René
"Le Ciel m’est témoin, mon frère, que je donnerais
mille fois ma vie pour vous épargner un moment de peine;
mais, infortunée que je suis, je ne puis rien pour votre
bonheur. Vous me pardonnerez donc de m’être dérobée
de chez vous, comme une coupable: je n’aurais pu résister
à vos prières, et cependant il fallait partir...
Mon Dieu, ayez pitié de moi!
Vous savez, René, que j’ai toujours eu du penchant pour
la vie religieuse: il est temps que je mette à profit les
avertissements du Ciel. Pourquoi ai-je attendu si tard? Dieu m’en
punit. J’étais restée pour vous dans le monde...
Pardonnez, je suis toute troublée par le chagrin que j’ai
de vous quitter.
C’est à présent, mon cher frère, que je
sens bien la nécessité de ces asiles, contre lesquels
je vous ai vu souvent vous élever. II est des malheurs
qui nous séparent pour toujours des hommes: que deviendraient
alors de pauvres infortunées?... Je suis persuadée
que vous-même, mon frère, vous trouveriez le repos
dans ces retraites de la religion: la terre n’offre rien qui soit
digne de vous.
Je ne vous rappellerai point votre serment: je connais la fidélité
de votre parole. Vous l’avez juré, vous vivrez pour moi.
Y a-t-il rien de plus misérable, que de songer sans cesse
à quitter la vie? Pour un homme de votre caractère,
il est si aisé de mourir! Croyez-en votre soeur, il est
plus difficile de vivre. Mais, mon frère, sortez au plus
vite de la solitude, qui ne vous est pas bonne; cherchez quelque
occupation. Je sais que vous riez amèrement de cette nécessité
où l’on est en France de prendre un état.
Ne méprisez pas tant l’expérience et la sagesse
de nos pères. Il vaut mieux, mon cher René, ressembler
un peu plus au commun des hommes, et avoir un peu moins de malheur.
Peut-être trouveriez-vous dans le mariage un soulagement
à vos ennuis. Une femme, des enfants occuperaient vos jours.
Et quelle est la femme qui ne chercherait pas à vous rendre
heureux! L’ardeur de votre âme, la beauté de votre
génie, votre air noble et passionné, ce regard fier
et tendre, tout vous assurerait de son amour et de sa fidélité.
Ah! avec quelles délices ne te presserait-elle pas dans
ses bras et sur son coeur! Comme tous ses regards, toutes ses
pensées seraient attachés sur toi pour prévenir
tes moindres peines! Elle serait tout amour, toute innocence devant
toi; tu croirais retrouver une soeur.
Je pars pour le couvent de... Ce monastère, bâti
au bord de la mer, convient à la situation de mon âme.
La nuit, du fond de ma cellule, j’entendrai le murmure des flots
qui baignent les murs du couvent; je songerai à ces promenades
que je faisais avec vous, au milieu des bois, alors que nous croyions
retrouver le bruit des mers dans la cime agitée des pins.
Aimable compagnon de mon enfance, est-ce que je ne vous verrai
plus? A peine plus âgée que vous, je vous balançais
dans votre berceau; souvent nous avons dormi ensemble. Ah! si
un même tombeau nous réunissait un jour! Mais non:
je dois dormir seule sous les marbres glacés de ce sanctuaire
où reposent pour jamais ces filles qui n’ont point aimé.
Je ne sais si vous pourrez lire ces lignes à demi effacées
par mes larmes. Après tout, mon ami, un peu plus tôt,
un peu plus tard, n’aurait-il pas fallu nous quitter? Qu’ai-je
besoin de vous entretenir de l’incertitude et du peu de valeur
de la vie? Vous vous rappelez le jeune M... qui fit naufrage
à l’Ile-de-France. Quand vous reçûtes sa dernière
lettre, quelques mois après sa mort, sa dépouille
terrestre n’existait même plus, et l’instant où vous
commenciez son deuil en Europe était celui où on
le finissait aux Indes. Qu’est-ce donc que l’homme, dont la mémoire
périt si vite? Une partie de ses amis ne peut apprendre
sa mort, que l’autre n’en soit déjà consolée!
Quoi, cher et trop cher René, mon souvenir s’effacera-t-il
si promptement de ton coeur? O mon frère, si je m’arrache
à vous dans le temps, c’est pour n’être pas séparée
de vous dans l’éternité.
Amélie
P. S. Je joins ici l’acte de donation de mes biens; j’espère
que vous ne refuserez pas cette marque de mon amitié."
La foudre qui fût tombée à mes pieds ne m’eût
pas causé plus d’effroi que cette lettre. Quel secret Amélie
me cachait-elle? Qui la forçait si subitement à
embrasser la vie religieuse? Ne m’avait-elle rattaché à
l’existence par le charme de l’amitié que pour me délaisser
tout à coup? Oh! pourquoi était-elle venue me détourner
de mon dessein! Un mouvement de pitié l’avait rappelée
auprès de moi, mais bientôt fatiguée d’un
pénible devoir, elle se hâte de quitter un malheureux
qui n’avait qu’elle sur la terre. On croit avoir tout fait quand
on a empêché un homme de mourir! Telles étaient
mes plaintes. Puis faisant un retour sur moi-même: "Ingrate
Amélie, disais-je, si tu avais été à
ma place, si, comme moi, tu avais été perdue dans
le vide de tes jours, ah! tu n’aurais pas été abandonnée
de ton frère."
Cependant, quand je relisais la lettre, j’y trouvais je ne sais
quoi de si triste et de si tendre, que tout mon coeur se fondait.
Tout à coup il me vint une idée qui me donna quelque
espérance: je m’imaginai qu’Amélie avait peut-être
conçu une passion pour un homme qu’elle n’osait avouer.
Ce soupçon sembla m’expliquer sa mélancolie, sa
correspondance mystérieuse, et le ton passionné
qui respirait dans sa lettre. Je lui écrivis aussitôt
pour la supplier de m’ouvrir son coeur.
Elle ne tarda pas à me répondre, mais sans me découvrir
son secret: elle me mandait seulement qu’elle avait obtenu les
dispenses du noviciat, et qu’elle allait prononcer ses voeux.
Je fus révolté de l’obstination d’Amélie,
du mystère de ses paroles, et de son peu de confiance en
mon amitié.
Après avoir hésité un moment sur le parti
que j’avais à prendre, je résolus d’aller à
B... pour faire un dernier effort auprès de ma soeur. La
terre où j’avais été élevé
se trouvait sur la route. Quand j’aperçus les bois où
j’avais passé les seuls moments heureux de ma vie, je ne
pus retenir mes larmes, et il me fut impossible de résister
à la tentation de leur dire un dernier adieu.
Mon frère aîné avait vendu l’héritage
paternel, et le nouveau propriétaire ne l’habitait pas.
J’arrivai au château par la longue avenue de sapins; je
traversai à pied les cours désertes; je m’arrêtai
à regarder les fenêtres fermées ou demi-brisées,
le chardon qui croissait au pied des murs, les feuilles qui jonchaient
le seuil des portes, et ce perron solitaire où j’avais
vu si souvent mon père et ses fidèles serviteurs.
Les marches étaient déjà couvertes de mousse;
le violier jaune croissait entre leurs pierres déjointes
et tremblantes. Un gardien inconnu m’ouvrit brusquement les portes.
J’hésitais à franchir le seuil; cet homme s’écria:
"Eh bien! allez-vous faire comme cette étrangère
qui vint ici il y a quelques jours? Quand ce fut pour entrer,
elle s’évanouit, et je fus obligé de la reporter
à sa voiture." II me fut aisé de reconnaître
l’étrangère qui, comme moi, était
venue chercher dans ces lieux des pleurs et des souvenirs!
Couvrant un moment mes yeux de mon mouchoir, j’entrai sous le
toit de mes ancêtres. Je parcourus les appartements sonores
où l’on n’entendait que le bruit de mes pas. Les chambres
étaient à peine éclairées par la faible
lumière qui pénétrait entre le volets fermés:
je visitai celle où ma mère avait perdu la vie en
me mettant au monde, celle où se retirait mon père,
celle où j’avais dormi dans mon berceau, celle enfin où
l’amitié avait reçu mes premiers voeux dans le sein
d’une soeur. Partout les salles étaient détendues,
et l’araignée filait sa toile dans les couches abandonnées.
Je sortis précipitamment de ces lieux, je m’en éloignai
à grands pas, sans oser tourner la tête. Qu’ils sont
doux, mais qu’ils sont rapides, les moments que les frères
et les soeurs passent dans leurs jeunes années, réunis
sous l’aile de leurs vieux parents! La famille de l’homme n’est
que d’un jour; le souffle de Dieu la disperse comme une fumée.
A peine le fils connaît-il le père, le père
le fils, le frère la soeur, la soeur le frère! Le
chêne voit germer ses glands autour de lui: il n’en est
pas ainsi des enfants des hommes!
En arrivant à B..., je me fis conduire au couvent; je
demandai à parler à ma soeur. On me dit qu’elle
ne recevait personne. Je lui écrivis: elle me répondit
que, sur le point de se consacrer à Dieu, il ne lui était
pas permis de donner une pensée au monde; que si je l’aimais,
j’éviterais de l’accabler de ma douleur. Elle ajoutait:
"Cependant si votre projet est de paraître à
l’autel le jour de ma profession, daignez m’y servir de père;
ce rôle est le seul digne de votre courage, le seul qui
convienne à notre amitié, et à mon repos."
Cette froide fermeté qu’on opposait à l’ardeur
de mon amitié, me jeta dans de violents transports. Tantôt
j’étais près de retourner sur mes pas; tantôt
je voulais rester, uniquement pour troubler le sacrifice. L’enfer
me suscitait jusqu’à la pensée de me poignarder
dans l’église, et de mêler mes derniers soupirs aux
voeux qui m’arrachaient ma soeur. La supérieure du couvent
me fit prévenir qu’on avait préparé un banc
dans le sanctuaire, et elle m’invitait à me rendre à
la cérémonie qui devait avoir lieu dès le
lendemain.
Au lever de l’aube, j’entendis le premier son des cloches...
Vers dix heures, dans une sorte d’agonie, je me traînai
au monastère. Rien ne peut plus être tragique quand
on a assisté à un pareil spectacle; rien ne peut
plus être douloureux quand on y a survécu.
Un peuple immense remplissait l’église. On me conduit
au banc du sanctuaire; je me précipite à genoux
sans presque savoir où j’étais, ni à quoi
j’étais résolu. Déjà le prêtre
attendait à l’autel; tout à coup la grille mystérieuse
s’ouvre, et Amélie s’avance, parée de toutes les
pompes du monde. Elle était si belle, il y avait sur son
visage quelque chose de si divin, qu’elle excita un mouvement
de surprise et d’admiration. Vaincu par la glorieuse douleur de
la sainte, abattu par les grandeurs de la religion, tous mes projets
de violence s’évanouirent; ma force m’abandonna; je me
sentis lié par une main toute-puissante, et, au lieu de
blasphèmes et de menaces, je ne trouvai dans mon coeur
que de profondes adorations et les gémissements de l’humilité.
Amélie se place sous un dais. Le sacrifice commence à
la lueur des flambeaux, au milieu des fleurs et des parfums, qui
devaient rendre l’holocauste agréable. A l’offertoire,
le prêtre se dépouilla de ses ornements, ne conserva
qu’une tunique de lin, monta en chaire, et, dans un discours simple
et pathétique, peignit le bonheur de la vierge qui se consacre
au Seigneur. Quand il prononça ces mots: "Elle a paru
comme l’encens qui se consume dans le feu", un grand calme
et des odeurs célestes semblèrent se répandre
dans l’auditoire; on se sentit comme à l’abri sous les
ailes de la colombe mystique, et l’on eût cru voir les anges
descendre sur l’autel et remonter vers les cieux avec des parfums
et des couronnes.
Le prêtre achève son discours, reprend ses vêtements,
continue le sacrifice. Amélie, soutenue de deux jeunes
religieuses, se met à genoux sur la dernière marche
de l’autel. On vient alors me chercher, pour remplir les fonctions
paternelles. Au bruit de mes pas chancelants dans le sanctuaire,
Amélie est prête à défaillir. On me
place à côté du prêtre, pour lui présenter
les ciseaux. En ce moment je sens renaître mes transports;
ma fureur va éclater, quand Amélie, rappelant son
courage, me lance un regard où il y a tant de reproche
et de douleur que j’en suis atterré. La religion triomphe.
Ma soeur profite de mon trouble; elle avance hardiment la tête.
Sa superbe chevelure tombe de toutes parts sous le fer sacré;
une longue robe d’étamine remplace pour elle les ornements
du siècle, sans la rendre moins touchante; les ennuis de
son front se cachent sous un bandeau de lin; et le voile mystérieux,
double symbole de la virginité et de la religion, accompagne
sa tête dépouillée. Jamais elle n’avait paru
si belle. L’oeil de la pénitente était attaché
sur la poussière du monde, et son âme était
dans le ciel.
Cependant Amélie n’avait point encore prononcé
ses voeux; et pour mourir au monde il fallait qu’elle passât
à travers le tombeau. Ma soeur se couche sur le marbre;
on étend sur elle un drap mortuaire; quatre flambeaux en
marquent les quatre coins. Le prêtre, l’étole au
cou, le livre à la main, commence l’Office des morts; de
jeunes vierges le continuent. O joies de la religion, que vous
êtes grandes, mais que vous êtes terribles! On m’avait
contraint de me placer à genoux, près de ce lugubre
appareil. Tout à coup un murmure confus sort de dessous
le voile sépulcral; je m’incline, et ces paroles épouvantables
(que je fus seul à entendre) viennent frapper mon oreille:
"Dieu de miséricorde, fais que je ne me relève
jamais de cette couche funèbre, et comble de tes biens
un frère qui n’a point partagé ma criminelle passion!"
A ces mots échappés du cercueil, l’affreuse vérité
m’éclaire; ma raison s’égare, je me laisse tomber
sur le linceul de la mort, je presse ma soeur dans mes bras, je
m’écrie: "Chaste épouse de Jésus-Christ,
reçois mes derniers embrassements à travers les
glaces du trépas et les profondeurs de l’éternité,
qui te séparent déjà de ton frère!"
Ce mouvement, ce cri, ces larmes, troublent la cérémonie,
le prêtre s’interrompt, les religieuses ferment la grille,
la foule s’agite et se presse vers l’autel; on m’emporte sans
connaissance. Que je sus peu de gré à ceux qui me
rappelèrent au jour! J’appris, en rouvrant les yeux, que
le sacrifice était consommé, et que ma soeur avait
été saisie d’une fièvre ardente. Elle me
faisait prier de ne plus chercher à la voir. O misère
de ma vie: une soeur craindre de parler à un frère,
et un frère craindre de faire entendre sa voix à
une soeur! Je sortis du monastère comme de ce lieu d’expiation
où des flammes nous préparent pour la vie céleste,
où l’on a tout perdu comme aux enfers, hors l’espérance.
On peut trouver des forces dans son âme contre un malheur
personnel; mais devenir la cause involontaire du malheur d’un
autre, cela est tout à fait insupportable. Eclairé
sur les maux de ma soeur, je me figurais ce qu’elle avait dû
souffrir. Alors s’expliquèrent pour moi plusieurs choses
que je n’avais pu comprendre: ce mélange de joie et de
tristesse, qu’Amélie avait fait paraître au moment
de mon départ pour mes voyages, le soin qu’elle prit de
m’éviter à mon retour, et cependant cette faiblesse
qui l’empêcha si longtemps d’entrer dans un monastère;
sans doute la fille malheureuse s’était flattée
de guérir! Ses projets de retraite, la dispense du noviciat,
la disposition de ses biens en ma faveur, avaient apparemment
produit cette correspondance secrète qui servit à
me tromper.
O mes amis, je sus donc ce que c’était que de verser des
larmes, pour un mal qui n’était point imaginaire! Mes passions,
si longtemps indéterminées, se précipitèrent
sur cette première proie avec fureur. Je trouvai même
une sorte de satisfaction inattendue dans la plénitude
de mon chagrin, et je m’aperçus, avec un secret mouvement
de joie, que la douleur n’est pas une affection qu’on épuise
comme le plaisir."
J’avais voulu quitter la terre avant l’ordre du Tout-Puissant;
c’était un grand crime: Dieu m’avait envoyé Amélie
à la fois pour me sauver et pour me punir. Ainsi, toute
pensée coupable, toute action criminelle entraîne
après elle des désordres et des malheurs. Amélie
me priait de vivre, et je lui devais bien de ne pas aggraver ses
maux. D’ailleurs (chose étrange!) je n’avais plus envie
de mourir depuis que j’étais réellement malheureux.
Mon chagrin était devenu une occupation qui remplissait
tous mes moments: tant mon coeur est naturellement pétri
d’ennui et de misère!
Je pris donc subitement une autre résolution; je me déterminai
à quitter l’Europe, et à passer en Amérique.
On équipait, dans ce moment même, au port de B...,
une flotte pour la Louisiane; je m’arrangeai avec un des capitaines
de vaisseau; je fis savoir mon projet à Amélie,
et je m’occupai de mon départ.
Ma soeur avait touché aux portes de la mort; mais Dieu,
qui lui destinait la première palme des vierges, ne voulut
pas la rappeler si vite à lui; son épreuve ici-bas
fut prolongée. Descendue une seconde fois dans la pénible
carrière de la vie, l’héroïne, courbée
sous la croix, s’avança courageusement à l’encontre
des douleurs, ne voyant plus que le triomphe dans le combat, et
dans l’excès des souffrances, l’excès de la gloire.
La vente du peu de bien qui me restait, et que je cédai
à mon frère, les longs préparatifs d’un convoi,
les vents contraires, me retinrent longtemps dans le port. J’allais
chaque matin m’informer des nouvelles d’Amélie, et je revenais
toujours avec de nouveaux motifs d’admiration et de larmes.
J’errais sans cesse autour du monastère bâti au
bord de la mer. J’apercevais souvent, à une petite fenêtre
grillée qui donnait sur une plage déserte, une religieuse
assise dans une attitude pensive; elle rêvait à l’aspect
de l’océan où apparaissait quelque vaisseau, cinglant
aux extrémités de la terre. Plusieurs fois, à
la clarté de la lune, j’ai revu la même religieuse
aux barreaux de la même fenêtre: elle contemplait
la mer, éclairée par l’astre de la nuit, et semblait
prêter l’oreille au bruit des vagues qui se brisaient tristement
sur des grèves solitaires.
Je crois encore entendre la cloche qui, pendant la nuit, appelait
les religieuses aux veilles et aux prières. Tandis qu’elle
tintait avec lenteur, et que les vierges s’avançaient en
silence à l’autel du Tout-Puissant, je courais au monastère:
là, seul au pied des murs, j’écoutais dans une sainte
extase, les derniers sons des cantiques, qui se mêlaient
sous les voûtes du temple au faible bruissement des flots.
Je ne sais comment toutes ces choses, qui auraient dû nourrir
mes peines, en émoussaient au contraire l’aiguillon. Mes
larmes avaient moins d’amertume lorsque je les répandais
sur les rochers et parmi les vents. Mon chagrin même, par
sa nature extraordinaire, portait avec lui quelque remède:
on jouit de ce qui n’est pas commun, même quand cette chose
est un malheur. J’en conçus presque l’espérance
que ma soeur deviendrait à son tour moins misérable.
Une lettre que je reçus d’elle avant mon départ
sembla me confirmer dans ces idées. Amélie se plaignait
tendrement de ma douleur, et m’assurait que le temps diminuait
la sienne. "Je ne désespère pas de mon bonheur,
me disait-elle. L’excès même du sacrifice, à
présent que le sacrifice est consommé, sert à
me rendre quelque paix. La simplicité de mes compagnes,
la pureté de leurs voeux, la régularité de
leur vie, tout répand du baume sur mes jours. Quand j’entends
gronder les orages, et que l’oiseau de mer vient battre des ailes
à ma fenêtre, moi, pauvre colombe du ciel, je songe
au bonheur que j’ai eu de trouver un abri contre la tempête.
C’est ici la sainte montagne, le sommet élevé d’où
l’on entend les derniers bruits de la terre, et les premiers concerts
du ciel; c’est ici que la religion trompe doucement une âme
sensible: aux plus violentes amours elle substitue une sorte de
chasteté brûlante où l’amante et la vierge
sont unies; elle épure les soupirs; elle change en une
flamme incorruptible une flamme périssable; elle mêle
divinement son calme et son innocence à ce reste de trouble
et de volupté d’un coeur qui cherche à se reposer,
et d’une vie qui se retire."
Je ne sais ce que le ciel me réserve, et s’il a voulu
m’avertir que les orages accompagneraient partout mes pas. L’ordre
était donné pour le départ de la flotte;
déjà plusieurs vaisseaux avaient appareillé
au baisser du soleil; je m’étais arrangé pour passer
la dernière nuit à terre, afin d’écrire ma
lettre d’adieux à Amélie. Vers minuit, tandis que
je m’occupe de ce soin, et que je mouille mon papier de mes larmes,
le bruit des vents vient frapper mon oreille. J’écoute;
et au milieu de la tempête, je distingue les coups de canon
d’alarme, mêlés au glas de la cloche monastique.
Je vole sur le rivage où tout était désert,
et où l’on n’entendait que le rugissement des flots. Je
m’assieds sur un rocher. D’un côté s’étendent
les vagues étincelantes, de l’autre les murs sombres du
monastère se perdent confusément dans les cieux.
Une petite lumière paraissait à la fenêtre
grillée. Etait-ce toi, ô mon Amélie, qui prosternée
au pied du crucifix, priait le Dieu des orages d’épargner
ton malheureux frère? La tempête sur les flots, le
calme dans ta retraite; des hommes brisés sur des écueils
au pied de l’asile que rien ne peut troubler; l’infini de l’autre
côté du mur d’une cellule; les fanaux agités
des vaisseaux, le phare immobile du couvent; l’incertitude des
destinées du navigateur, la vestale connaissant dans un
seul jour tous les jours futurs de sa vie; d’une autre part, une
âme telle que la tienne, ô Amélie, orageuse
comme l’océan; un naufrage plus affreux que celui du marinier:
tout ce tableau est encore profondément gravé dans
ma mémoire. Soleil de ce ciel nouveau maintenant témoin
de mes larmes, écho du rivage américain qui répétez
les accents de René, ce fut le lendemain de cette nuit
terrible, qu’appuyé sur le gaillard de mon vaisseau, je
vis s’éloigner pour jamais ma terre natale! Je contemplai
longtemps sur la côte les derniers balancements des arbres
de la patrie, et les faîtes du monastère qui s’abaissaient
à l’horizon."
Comme René achevait de raconter son histoire, il tira
un papier de son sein, et le donna au P. Souël; puis, se
jetant dans les bras de Chactas, et étouffant ses sanglots,
il laissa le temps au missionnaire de parcourir la lettre qu’il
venait de lui remettre.
Elle était de la Supérieure de... Elle contenait
le récit des derniers moments de la soeur Amélie
de la Miséricorde, morte victime de son zèle et
de sa charité, en soignant ses compagnes attaquées
d’une maladie contagieuse. Toute la communauté était
inconsolable, et l’on y regardait Amélie comme une sainte.
La Supérieure ajoutait que, depuis trente ans qu’elle était
à la tête de la maison, elle n’avait jamais vu de
religieuse d’une humeur aussi douce et aussi égale, ni
qui fût plus contente d’avoir quitté les tribulations
du monde.
Chactas pressait René dans ses bras; le vieillard pleurait.
"Mon enfant, dit-il à son fils, je voudrais que le
P. Aubry fût ici, il tirait du fond de son coeur je ne sais
quelle paix qui, en les calmant, ne semblait cependant point étrangère
aux tempêtes; c’était la lune dans une nuit orageuse;
les nuages errants ne peuvent l’emporter dans leur course; pure
et inaltérable, elle s’avance tranquille au-dessus d’eux.
Hélas, pour moi, tout me trouble et m’entraîne!"
Jusqu’alors le P. Souël, sans proférer une parole,
avait écouté d’un air austère l’histoire
de René. II portait en secret un coeur compatissant, mais
il montrait au dehors un caractère inflexible; la sensibilité
du Sachem le fit sortir du silence:
Rien, dit-il au frère d’Amélie, rien ne mérite,
dans cette histoire, la pitié qu’on vous montre ici. Je
vois un jeune homme entêté de chimères, à
qui tout déplaît et qui s’est soustrait aux charges
de la société pour se livrer à d’inutiles
rêveries. On n’est point, monsieur, un homme supérieur
parce qu’on aperçoit le monde sous un jour odieux. On ne
hait les hommes et la vie, que faute de voir assez loin. Etendez
un peu plus votre regard, et vous serez bientôt convaincu
que tous ces maux dont vous vous plaignez sont de purs néants.
Mais quelle honte de ne pouvoir songer au seul malheur réel
de votre vie sans être forcé de rougir! Toute la
pureté, toute la vertu, toute la religion, toutes les couronnes
d’une sainte rendent à peine tolérable la seule
idée de vos chagrins. Votre soeur a expié sa faute;
mais, s’il faut dire ici ma pensée, je crains que, par
une épouvantable justice, un aveu sorti du sein de la tombe
n’ait troublé votre âme à son tour. Que faites-vous
seul au fond des forêts où vous consumez vos jours
négligeant tous vos devoirs? Des saints, me direz-vous,
se sont ensevelis dans les déserts? Ils y étaient
avec leurs larmes et employaient à éteindre leurs
passions le temps que vous perdez peut-être à allumer
les vôtres. Jeune présomptueux qui avez cru que l’homme
se peut suffire à lui-même! La solitude est mauvaise
à celui qui n’y vit pas avec Dieu; elle redouble les puissances
de l’âme, en même temps qu’elle leur ôte tout
sujet pour s’exercer. Quiconque a reçu des forces, doit
les consacrer au service de ses semblables, s’il les laisse inutiles,
il en est d’abord puni par une secrète misère, et
tôt ou tard le ciel lui envoie un châtiment effroyable."
Troublé par ces paroles, René releva du sein de
Chactas sa tête humiliée. Le Sachem aveugle se prit
à sourire; et ce sourire de la bouche, qui ne se mariait
plus à celui des yeux, avait quelque chose de mystérieux
et de céleste. "Mon fils, dit le vieil amant d’Atala,
il nous parle sévèrement; il corrige et le vieillard
et le jeune homme, et il a raison. Oui, il faut que tu renonces
à cette vie extraordinaire qui n’est pleine que de soucis:
il n’y a de bonheur que dans les voies communes.
Un jour le Meschacebé, encore assez près de sa
source, se lassa de n’être qu’un limpide ruisseau. Il demande
des neiges aux montagnes, des eaux aux torrents, des pluies aux
tempêtes, il franchit ses rives, et désole ses bords
charmants. L’orgueilleux ruisseau s’applaudit d’abord de sa puissance;
mais voyant que tout devenait désert sur son passage; qu’il
coulait, abandonné dans la solitude; que ses eaux étaient
toujours troublées, il regretta l’humble lit que lui avait
creusé la nature, les oiseaux, les fleurs, les arbres et
les ruisseaux, jadis modestes compagnons de son paisible cours."
Chactas cessa de parler, et l’on entendit la voix du flamant
qui, retiré dans les roseaux du Meschacebé, annonçait
un orage pour le milieu du jour. Les trois amis reprirent la route
de leurs cabanes: René marchait en silence entre le missionnaire
qui priait Dieu, et le Sachem aveugle qui cherchait sa route.
On dit que, pressé par les deux vieillards, il retourna
chez son épouse, mais sans y trouver le bonheur. Il périt
peu de temps après avec Chactas et le P. Souël, dans
le massacre des Français et des Natchez à la Louisiane.
On montre encore un rocher où il allait s’asseoir au soleil
couchant.
Notes
-
Colonie française aux Natchez. (Retour au texte)
-
A Londres, derrière White-Hall, la statue de Charles II. (Retour au texte)
-
Louis XIV. (Retour au texte)
Text prepared by
- Anasse Razak Ouedraogo
- Stephane Simo
Source
Chateaubriand, François-René de. René. 1802. Paris: Haar & Steinert, 1912. Internet Archive. 7 Apr. 2010. Web. 4 July 2013. <http:// archive.org/ details/ renchateaubria 00chat>.

Anthology of Louisiana Literature